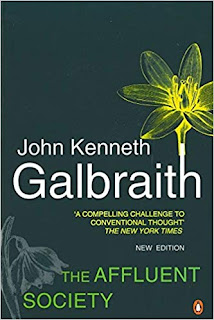Que m’inspire The affluent society de John Galbraith ? (voir Société d’abondance.)
Bien vieilli ?
Galbraith parlait d’une autre époque que la nôtre. De son temps, la technostructure dominait le monde. La planification régnait. Mais, sur le fond, son analyse est actuelle. Ce qui n’allait pas s’est maintenu, c’est le reste qui s’est dégradé.
- La menace qui plane sur notre société est la dette, et l’inflation. Et effectivement nous avons vécu une ère d’hyper inflation. Simplement nous ne nous en sommes pas rendu compte : elle a touché l’immobilier, le monde financier et la valeur des entreprises, pas les biens de consommation.
- Notre société est tirée par les exigences d’une production compulsive : nous vivons les yeux rivés sur la croissance de l’économie ; nous respirons quand le PIB augmente, quand nous produisons « plus ».
- Cette production exige que nous soyons conditionnés à consommer l’inutile, voire le nocif, et ce de manière croissante.
- Le secteur public est fondamental, insuffisamment financé, l’individu subit les conséquences de ce déséquilibre, notamment parce que le plus pauvre est élevé pour n’être que consommateur.
- Ce que cherche l’homme, le critère ultime d’évaluation d’un modèle social, c’est la « sécurité », pas la richesse matérielle.
Lavage de cerveau
Enorme sentiment de manipulation. Sans discussion, sans débat, nous avons basculé d’une société de citoyens « liberté, égalité, fraternité », à un monde réglé par les lois du marché.
Pour cela, il suffisait de nous persuader que le service public, c’était le mal, l’inefficacité, et que le secteur privé était le bien, ce qui créait de la richesse pour tous, qui engraissait le paresseux.
Il y a encore trente ou quarante ans, le Français était sûr de l’efficacité de son administration. L’élite de la nation, c’était le Polytechnicien et l’instituteur, agents de l’état, modestes, peu payés, mais jouissant d’une immense reconnaissance, presque plus pour le sacrifice financier qu’ils consentaient à la nation que pour l’excellence de leur intellect. Le symbole de la transformation que nous avons subie : partout des écoles de commerce et de management. Jadis méprisées, elles couvrent désormais le territoire et forment ceux qui ont les plus belles carrières.
L’ultralibéralisme, la théorie de la misère, a un grand mérite, qui explique probablement son succès : il permet au riche de s’enrichir en toute bonne conscience et convainc le pauvre qu’il n’a aucun droits sociaux.
De l’abondance à la misère
Galbraith pense que, grâce au progrès technologique, il y a eu passage d’une société de la misère à une société de l’abondance mue par une volonté de sécurité (emploi, revenus). Je soupçonne une faiblesse dans son raisonnement.
Le modèle de la misère, qui est celui qui inspire les textes d’économie, est revenu ces dernières décennies. C’est le « Consensus de Washington». Il a produit partout les mêmes résultats : augmentation du niveau de vie moyen et apparition de la pauvreté, de « l’insécurité ».
L’étude du CREDOC que je cite ailleurs n’illustre-t-elle pas ce fait ? La France, qui est probablement un des pays à avoir été le moins affecté par ce phénomène, a vu s’enrichir les riches avec dégradation corrélative de la sécurité de ses citoyens : si l’on retire les fonctionnaires des statistiques du CREDOC, on voit que quasiment la totalité de la population française a connu le chômage. En outre l’accession à la propriété est en net recul depuis 15 ans. Sans oublier le SDF que j’ai vu apparaître dans le métro en 1992. Il était inconcevable avant. Il y avait bien des clochards, mais c’étaient de gentils asociaux ; désormais, la société chassait ses membres, ils ne la quittaient plus de leur propre volonté.
J’en tire la présomption suivante. Il existe un modèle de la pauvreté, ou plutôt de la rareté, et un modèle de l’abondance, ou plutôt de la sécurité, et ils sont en grande partie indépendants de notre capacité de production, contrairement à ce que pensait Galbraith. Ils trahissent probablement des états d’esprit différents : individualisme ou solidarité.
J’irai cracher sur vos tombes
Cette réflexion m’amène à Boris Vian, et au livre qui a le titre de ce paragraphe. Il s’y révolte contre le racisme américain. Mais le sentiment qu’il dénonce est-il réservé au noir ? N’est-ce pas plutôt la manifestation d’un cancer qui peut frapper tout homme (le marchand et l’Anglo-saxon y étant prédisposés) ? Un cancer qui ne lui fait voir de l’existence que les grosses Mercedes et les grandes maisons ? Qui le pousse à désirer la mort de tout ce qui représente le non matériel : l’homme, la société, et la joie de vivre, le noir et la mère de famille ?
Compléments :
- La technostructure : L’ère de la planification.
- L’étude du CREDOC : Inégalités françaises ?
- Comment le petit entrepreneur américain (tel que le parti républicain le fait parler) justifie qu’il est bien de laisser crever son prochain : Propagande américaine.
- Une traduction en Français : Pour un salarié adaptable ?
- Sur l’éducation du citoyen pour la consommation (et par la télévision) : Médiamorphose.
- Ce que la société anglo-saxonne a d’abjecte (ce que dénonce Boris Vian) est qu’elle massacre volontiers celui qui est sans défense, comme l’a montré le combat des noirs pour leurs droits (voir PATTERSON, James T., Grand Expectations: The United States, 1945-1974, Oxford University Press, 1996.), et comme le prouvent de multiples incidents quotidiens (Inquiétante Amérique).